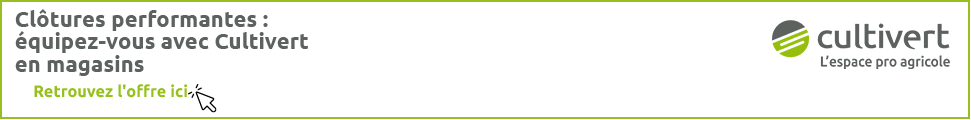La crise du Covid a conduit à exhumer un des piliers fondamentaux de toute société humaine : sa nécessaire souveraineté alimentaire. Mais de quoi parle-t-on, interroge Alessandra Kirsch, directrice des études du think-tank Agriculture Stratégies, qui intervenait au débat consacré à cette thématique lors de l’assemblée générale de la CBCMA, à Saint Brieuc.
1/3 de la consommation nationale de fromage importée
Le lait, un cas d’école
« La souveraineté alimentaire, c’est le droit des peuples à suivre des régimes alimentaires sains et culturellement adaptés à base de denrées alimentaires produites de façon durable », résume-t-elle. Autrement dit, on peut être largement excédentaire en volume pour une production sur le territoire national et être dépendant des importations car « la capacité de transformation, par exemple, ne permet pas de répondre à la demande ». Pour cette spécialiste, le lait est à cet égard un cas d’école : « Les importations couvrent 1/3 de la consommation nationale. Exemple, le taux d’auto-approvisionnement en fromage est de 120 % mais on importe 36 % des fromages consommés en France ».
Cette illustration tord le cou à tous ceux qui instillent qu’il suffit de fermer les frontières, de produire sur place pour assurer la souveraineté alimentaire. C’est bien méconnaître l’environnement économique qui permet par exemple de transformer le blé en pain ou en pâtes – des pâtes importées à 55 % alors que nous produisons 144 % de nos besoins de blé dur. « C’est comme la petite musique qui voudrait que l’on répartisse l’élevage sur le territoire. C’est une fois encore méconnaître l’économie de l’élevage qui intègre les outils industriels, les transports, etc., jusqu’au vétérinaire », cite Alessandra Kirsch. Et si la valeur de la production agricole bretonne représente aujourd’hui 11,2 milliards d’euros, c’est bien parce qu’elle a su s’appuyer sur un écosystème complexe, puissant et innovant.
Agriculture idéaliste et agriculture réaliste
Reste que cet appareil de production ‘intensif’ (qui fait le job comme on dit trivialement, c’est-à-dire « produire ce que le consommateur achète ») accuse des coups de boutoir récurrents. « On constate une politisation de la production agricole » décrypte Hervé Le Prince, dirigeant-fondateur de NewSens. Et ce responsable d’agence de communication d’inviter « à ne pas rentrer dans ce jeu » qui oppose « agrobusiness et agriculture familiale ». Il invite « à mener un combat face à cette idéologie simpliste qui oppose agriculture idéaliste et agriculture réaliste ».
« Le modèle de l’agriculture bretonne est pluriel », tempère pour sa part Gaël Guégan, directeur du Développement économique au Conseil régional de Bretagne. Une façon très politique et réaliste de rappeler qu’il y a « une place pour la production de masse et celle destinée aux consommateurs qui ont davantage de pouvoir d’achat ». Et de rappeler ce qui caractérise la Bretagne : « Sa particularité climatique pour produire des denrées agricoles et sa capacité à produire des emplois et de la valeur ». Une position que la région entend conforter avec son cap de « 1 000 installations par an » dans un objectif de « durabilité économique et environnementale ».